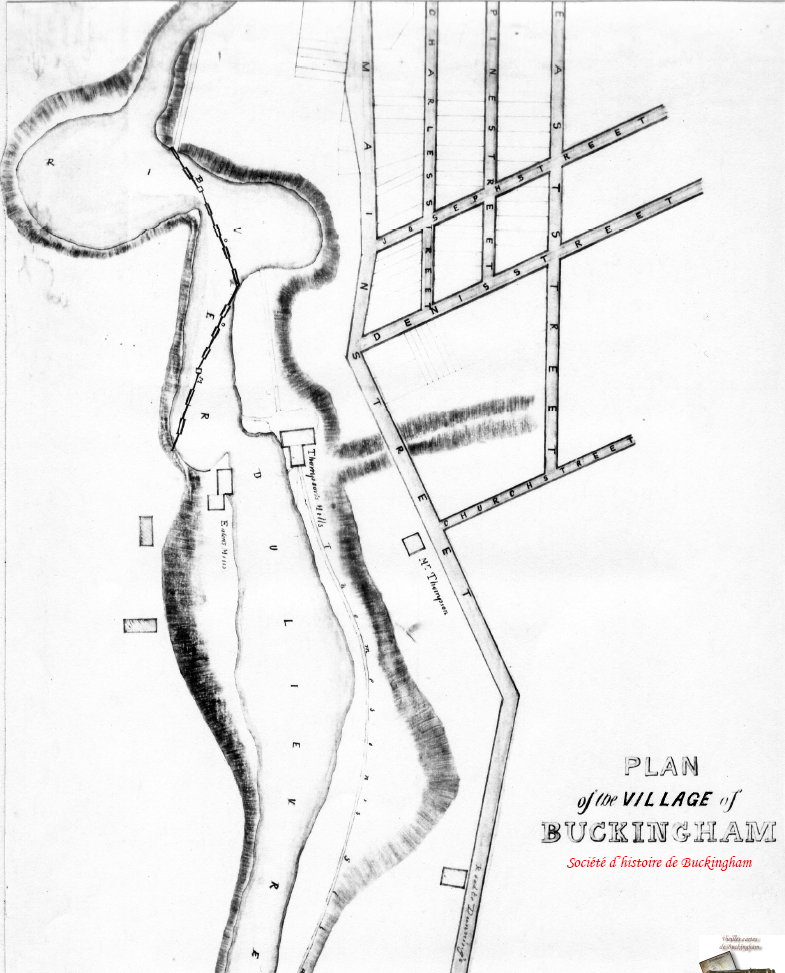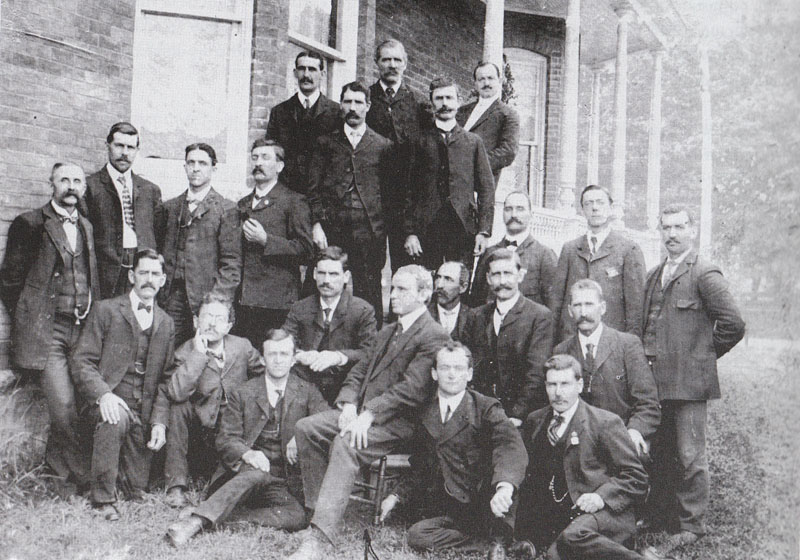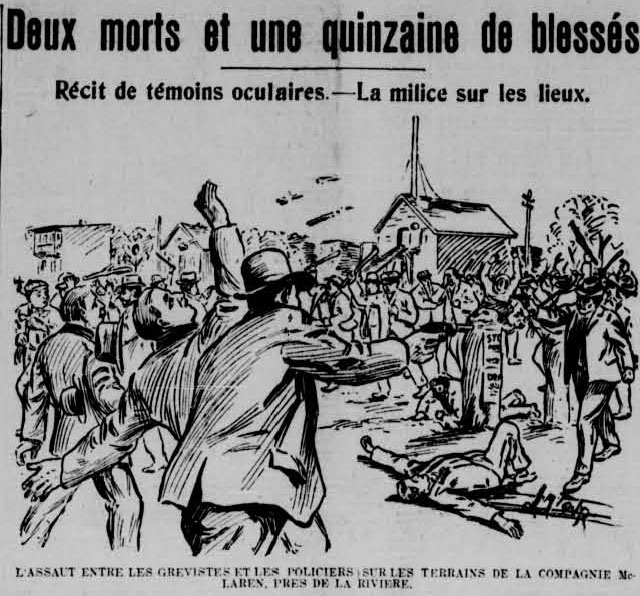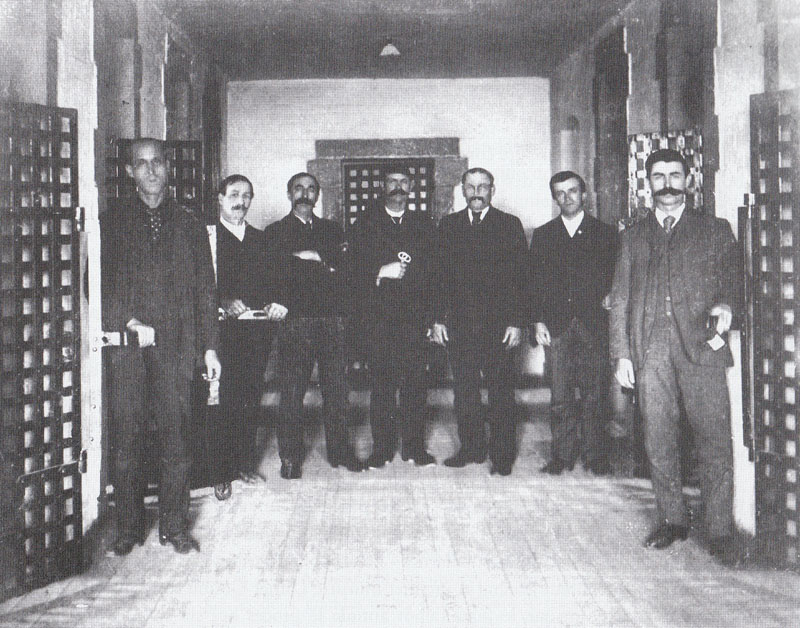|


| |
Les Landry de Buckingham
Voir aussi Louis Landry de Buckingham.
1826
Les moulins à scie Bowman et
Bigelow sont les seuls industries de Buckingham entre 1826 et 1860. La région
commence à grossir et la paroisse catholique est établi en 1840. Il y a alors
90 familles catholiques à Buckingham. Il y a un excellent article par Serge
Boudreau qui donne l'état de la région en 1846 mais aucun Landry n'est
mentionné.
Serge Boudrau, Les Pionniers de
La Lièvre en 1846, dans Mémoire, vol. 65, no. 1, cahier 279, printemps 2014,
page 47-66
1845-1850
Deux fils de
Alexis Félix Landry
quitte la région de Maskinongé pour s'établir à Buckingham un peu avant 1845. À
Buckingham,
Michel
Landry épouse Marguerite Beauchamp en 1845 et son frère
Félix
Landry épouse
en 1850 Adélaïde Beauchamp, la soeur de Marguerite. Les Beauchamps étaient
originaire de Pierrefonds. Ils seront encore là en 1861.
1851-1852
Le recensement de 1852
pour Buckingham a été perdu.
Recensement 1852. 260 Buckingham township The manuscript census returns for this
sub-district/division no longer exist
1855
Carte de la ville de Buckingham en 1855
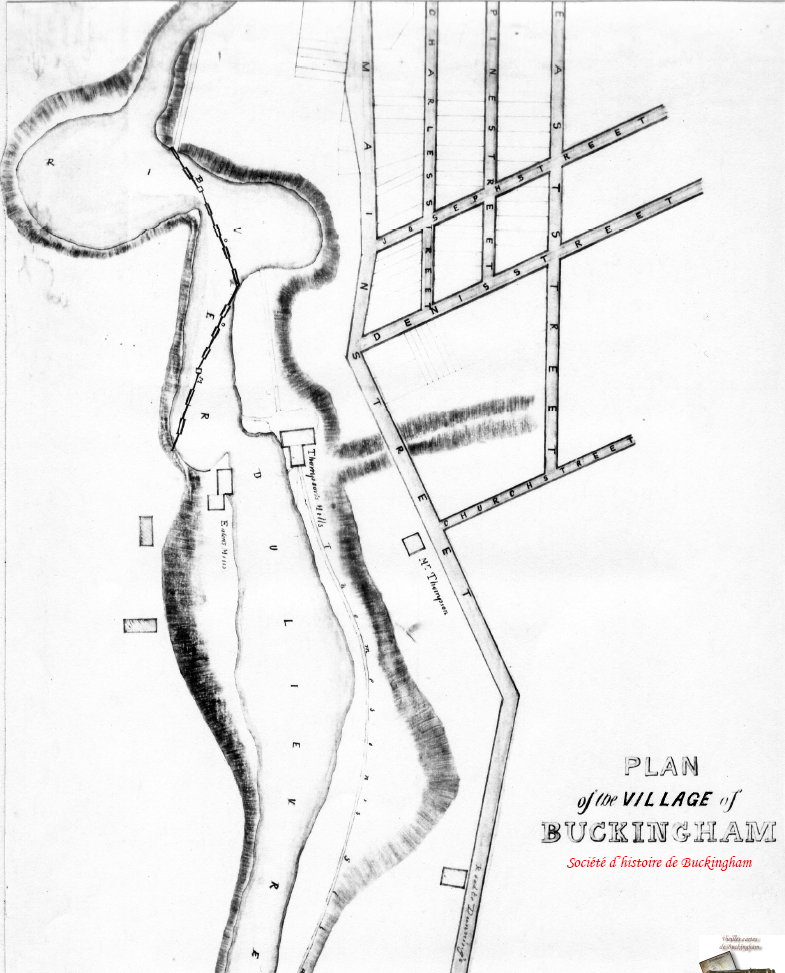
Source : Numérisée par la Société d'histoire de Buckingham.
https://www.histoiredebuckingham.com/
1861
| |
|
| Landry Felix, Adaline, Marie |
Félix Landry, son épouse Adélaïde Beauchamp. Il est le frère de Michel. |
| Landry Louis, Vitaline, Alexina, Louis JR |
Louis
Landry frère de Félix et Michel. |
| Landry Michel, Margoret, Clarice, Silinas, Louis, Michel |
Michel Landry et son épouse Marguerite. Les enfants Clarisse, Céline,
Louis et Michel. Ce Louis sera le grand-père de
Jean-Louis Landry. |
Référence : Historique Buckingham, André P. Joyce & Helen Séguin.
1871
| |
|
| Landry Michel, Margaret, Celinas, Louis, Michel, Joseph,
Onezime |
Michel Landry et son épouse Marguerite. Seule Clarisse est mariée. Il
reste Céline, Louis, Michel, Joseph et Onésime. |
| |
|
| |
|
Référence : Historique Buckingham, André P. Joyce & Helen Séguin.
https://maclaren.iquebec.com/
1879
En 1879
Louis Landry épouse
Laure Daoust à l'église de St-Grégoire-de-Nazianze. Sont nés Louis en 1880, Joseph 1882, Calixte en 1884 et Alexina en
1888. Louis est décédé très jeune, en 1888 à 34 ans. Laure devient veuve avec 4
enfants et lui survivra jusqu'en 1947.
1881
| Recensement 1881 |
|
| Landrie Louis, Laure, Louis |
Louis Landry, sa femme Laure et leur premier enfant, Louis. |
| Landry Margret, Michel, Lezime, Joseph |
Veuve
Marguerite Beauchamps Landry. Céline et Louis sont mariés. Il reste
Michel, Joseph et Onésime. |
| |
|
Référence : Historique Buckingham, André P. Joyce & Helen Séguin.
https://maclaren.iquebec.com/
1888
Décès de
Louis
Landry à 34 ans, grand-père de Jean-Louis Landry.
1891
| Recensement 1891 |
|
| Landrie Lorie, Louis, Joseph, Calixt, Elixinou. |
La famille de
Laure Daoust Landry. |
| |
|
| |
|
Référence : Historique Buckingham, André P. Joyce & Helen Séguin.
https://maclaren.iquebec.com/
1895
Dans le document HISTORIQUE DU COLLÈGE ST- MICHEL
https://maclaren.iquebec.com/ on y
parle du frère Ambrosio et du frère William comme directeur de l'école
Saint-Michel. Sur la photo des Écoliers de Buckingham de 1895-1896 avec
Joseph
Landry et
Calixte Landry, il y a le frère Ambrosio.

Écoliers du Collège St-Michel 1895-1896 dont Calixte Landry et Joseph Landry.
Source: JOYCE, André P., Buckingham : son histoire, son
patrimoine, Buckingham, ECO, 1982, page 37.
1901
|
Recensement 1901 - 16
avril - 160_b-5_tableau1_page5_Quebec_Labelle_Buckingham |
|
Lignes 40 à 44 Famille Laure
Landry |
|
|
40 Landry Laure F Head W May 15
1859 41 merchant
41 Landry Louis M Son S Sep 4 1880 20 christian brother
42 Landry Joseph M Son S May 15 1882 18 butcher
43 Landry Calixte M Son S Jul 31 1884 16 student
44 Landry Alexina F Daughter S Feb 14 1888 13
.
. |
-Laure
Daoust Landry, commerçante, probablement épicerie.
-20 ans frère des Écoles Chrétiennes, étudiant.
-Boucher dans l'épicerie de sa mère.
-Aux études, il deviendra prêtre.
-13 ans.
-La famille de Laure Landry
demeure tout près du presbytère. Elle est toujours bien impliquée dans les
activités de la paroisse. |
|
Lignes 45-47 Famille Victor
Montpellier |
|
|
Lignes 48-49 Probablement le
presbytère
48 Rev Father Michel 1873-1901.
49 Rev Father Raymond
50 Maria Baker domestique |
-
C'est le curé de la paroisse
François Michel.
-
- |
|
Autres Landry dans le recensement
de Buckingham. |
- |
| LANDRIE Joseph, Joséphine, François, Beatrice, Reine M.,
Gilberte |
Joseph Landry est le frère de Louis, époux décédé de Laure. |
Référence :
https://www.collectionscanada.gc.ca
___
1906
Exécutif syndical de l'Union international des ouvriers de Buckingham.
Louis Landry est assis à terre à gauche de Thomas Bélanger, Président du
syndicat, assis sur la chaise.
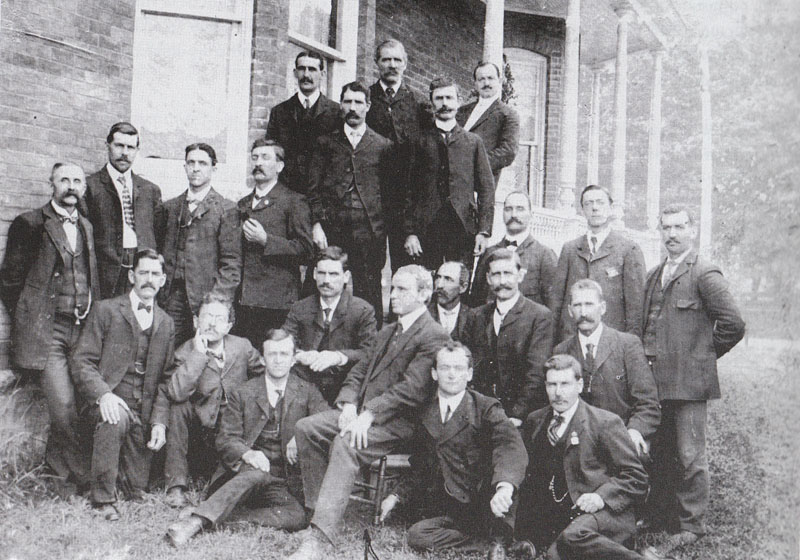
Publiée par Pierre Louis Lapointe dans son livre, La Vallée
Assiégée, 2006, page 142. Originalement dans le Ottawa Evening Journal, 25 octobre 1906,
page 1. Publié également par la Société d'histoire de Buckingham.
https://www.histoiredebuckingham.com/
Évènements du
8 octobre 1906
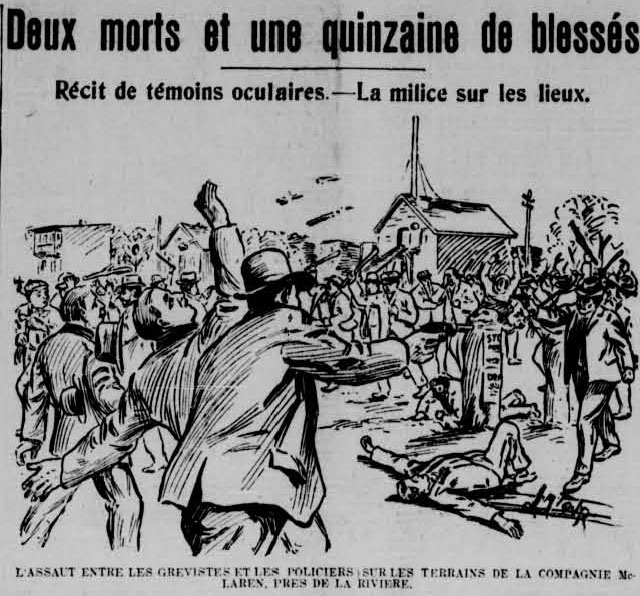
Dessin de la Une du journal La Patrie du 9 octobre 1906.
11 octobre 1906. Funérailles de Thomas Bélanger et François Thériault.
5 décembre 1906. Louis Landry envoyé à son procès pour sa participation à une émeute.
| Extrait d'une page Internet sur le site de la famille
Thériault (
https://www.genealogie.org/famille/theriault/Buckingham.htm ):
MORT
TRAGIQUE DE FRANÇOIS THÉRIAULT ET THOMAS BÉLANGER par Pierre-Louis Lapointe,
Ph.D., historien. Extraits de l’ouvrage de Pierre Louis Lapointe intitulé "
La vallée assiégée. Buckingham et la Basse-Lièvre sous les MacLaren,
1895-1945 ", (Éditions Vents d’Ouest, environ 300 pages, plus d’une centaine
de photographies, cartes et illustrations).
En guise de survol des événements qui précipitèrent l'affrontement du 8
octobre 1906, nous donnons la chronologie qui suit.
Printemps 1906
Réduction de la main-d'oeuvre à la compagnie MacLaren et surcharges de
travail. Ce resserrement de l'administration de l'entreprise est
probablement imputable aux besoins de liquidités occasionnés par l'ambitieux
programme de modernisation de l'ancienne scierie Ross et par le transport de
la cour à bois de Masson à Buckingham. De plus, les rentrées de fonds sont
ralenties considérablement à cause du niveau exceptionnellement bas de
l'eau, sur la Lièvre et sur l'Outaouais, ce qui retarde l'arrivée du bois
aux moulins et les expéditions par barges de Masson.
15 juillet 1906
Première rencontre préparatoire pour la mise sur pied d'une union tenue dans
le Bloc McCallum et Lahaie à l'angle de la rue Principale et de la rue
Joseph.
22 juillet 1906
Deuxième rencontre tenue cette fois au Collège Saint-Michel. Quatre cent
personnes sont présentes. Trois cent versent leur trois dollars et
promettent de verser une cotisation mensuelle de 35 à 40 cents.
29 juillet 1906
Troisième réunion tenue au Collège Saint-Michel. Des représentants syndicaux
de la région de Saint-Jean et de Montréal viennent rencontrer les membres.
Élection de l'exécutif syndical. Edmond Matte est élu président; Thomas
Bélanger, premier vice-président; Jean-Baptiste Clément, deuxième
vice-président; François Thériault, secrétaire-archiviste; Léonard Pagé,
secrétaire-financier et Thomas Lamontagne, trésorier.
Août 1906
Thomas Bélanger devient alors président de l'Union. Il n'a que vingt-cinq
ans. L’exécutif syndical de l’Union internationale des ouvriers de
Buckingham en 1906. Cette photographie, prise vraisemblablement par Rodolphe
Léger vers la fin du mois d’août 1906, circule sous forme de carte postale
avec l’intitulé anglais " Fair Wage Fighters ". Le groupe est rassemblé à
l’extrémité nord-est de la grande véranda de la maison de l’avocat Yvon
Lamontagne. Au fond, à droite, on distingue à peine le garde-fou du pont qui
enjambe alors le ravin qui traverse en diagonale le tracé de la rue
Principale. Assis, au centre de la photo, Thomas Bélanger, président ; assis
par terre à gauche de Bélanger,
Louis Landry et à droite Léonard Pagé ;
derrière lui, Jean-Baptiste Clément ; en haut , adossé au poteau de la
galerie, Yvon Lamontagne ; debout, devant Lamontagne, Adélard Hamelin, et à
gauche de ce dernier, Louis Gervais ; en plein centre, derrière Gervais et
Hamelin, vraisemblablement François Thériault.
Photographe Rodolphe Léger. Collection Pierre Louis Lapointe. Publiée dans
le Ottawa Evening Journal, 25 octobre 1906, p. 1.
15 août 1906
Thomas Bélanger, Eusèbe Lafleur et Xavier Tremblay rencontrent John Edward
Vallillee, gérant de la compagnie et maire de la ville.
Septembre 1906
Le Syndicat demande l'intervention des médiateurs provincial et fédéral.
10 septembre 1906
Une délégation de syndicalistes formée de Thomas Bélanger, Eusèbe Lafleur,
Georges Lafleur, Léandre Lafleur, Palma Proulx, Adélard Hamelin et plusieurs
autres présentent à J.E. Vallillee les demandes de l'Union, qui sont:
(i) Reconnaissance de l'Union
(ii) Réduction des heures de travail de onze heures à dix heures par jour
(iii) Augmentation du salaire de deux cents et demi de l'heure. Les ouvriers
recevaient alors 12 cents et demi de l'heure.
Rejet de leur demande.
12 septembre 1906
Lock-out décrété par J.E. Vallillee. Fermeture des moulins.
20 septembre 1906
Envoi d'une demande officielle de rencontre à Albert MacLaren par Thomas
Bélanger. Refus de rencontrer les membres de l'Union.
26 septembre 1906
Embauche, vers cette date, de la Thiel Detective Service par J.E. Vallillee.
1er octobre 1906
Félix Marois, médiateur du gouvernement du Québec se rend rencontrer Albert
MacLaren qui refuse de traiter avec l'Union. Il rencontre également les
membres du syndicat et transmet à Albert MacLaren une contre-offre des
syndiqués, offre qui est refusée. L'offre de médiation du gouvernement
fédéral est rejetée par Albert MacLaren, qui menace de cesser toute
production sur la Lièvre.
L'utilisation d'une agence privée de détectives qui se spécialise dans le "strike
breaking business" donne à toute cette affaire des allures de série noire.
On traite les ouvriers comme s'ils sont des criminels. On les fait suivre et
espionner et des agents doubles font rapport à leur chef E.R. Carrington
sous des noms fictifs. On dresse des listes de membres de l'Union et on fait
tirer des photographies des leaders syndicaux afin de bien les identifier.
Un de ces agents secrets signe ses rapports "Finis". Un autre donne la liste
de ceux qui ont assisté à la réunion du 1er octobre tenue au Bassin (Masson)
et ajoute que Bélanger est remonté à bicyclette jusqu'à Buckingham.
8 octobre 1906
Le matin du 8 octobre 1906, vers 9.00 heures, Albert et Alexander MacLaren
organisent la descente de billots près du "Landing" avec treize hommes.
C'est une provocation qui prend par surprise les syndicalistes. C'est aussi
un guet-apens, puisqu'on les y attend, retranchés sur les hauteurs et armés
jusqu'aux dents. Cette interprétation se trouve confirmée par les démarches
effectuées auprès de Rodolphe Léger pour obtenir une photographie de Thomas
Bélanger; par le caractère troublant d'une lettre de J.E. Vallillee à George
Millen de la Compagnie E.B. Eddy en date du 3 octobre 1906, et surtout, par
la nature et le nombre de blessures par balles qui vont terrasser Thomas
Bélanger. Le jeune président de l'Union est désigné comme cible.
Les unionistes marchent vers le Landing. Il est environ 13 heures. Les
hommes ont l'intention bien arrêtée de convaincre les employés de quitter le
travail. Ils s'approchent, parlementent et s'avancent à nouveau. Un ordre
sec claque soudainement dans l'air frais de ce 8 octobre : "Shoot them"! Une
rafale de coups de feu répond au commandement. Thomas Bélanger et François
Thériault s'affaissent, foudroyés. D'autres sont blessés. Estomaqués,
ahuris, révoltés, les unionistes montent à l'assaut et mettent en fuite ceux
qui viennent d'assassiner leurs amis. Dans les heures qui suivent John
Edward Vallillee obtient l'intervention de la milice, et, en fin de soirée,
117 d'entre eux s'installent à Buckingham. Le 10 octobre, un contingent des
Royal Canadian Dragoons, stationné à Saint-Jean, vient relever la milice. La
ville est sous occupation militaire jusqu'au 23 octobre : il n'en faut pas
plus pour que le calme revienne et pour que les moulins reprennent leur
activité.
Chez les ouvriers, c'est jour de deuil, et chez les familles les plus
éprouvées, il faut déjà songer à se refaire une nouvelle vie. Marie-Louise
Bélanger est enceinte d'un fils, Thomas, et Élisabeth Thériault est chargée
de la responsabilité de cinq enfants. Et dans les mois qui suivent, il y a
cette terrible parodie de justice qui, un an après "l'Affaire", condamne
seulement des ouvriers. Après l'érection d'un monument au cimetière, sur la
tombe de Bélanger et de Thériault, le silence s'installe comme un linceul
sur la petite ville de Buckingham. La liste noire fait le reste. Près du
quart de la population quitte la ville pour Cobalt, pour Fasset, pour
Bathurst, pour des endroits où il est possible de refaire sa vie et
d'oublier octobre 1906.
La ville de Buckingham bloque de sa mémoire collective ce dur épisode de son
histoire. Un mot d'ordre est donné: il faut oublier! Les procès-verbaux de
la ville sont d'ailleurs totalement muets à cet égard. On ne parle ni de
grève, ni de lock-out, ni de troubles, ni d'occupation militaire. C'est
comme si rien ne s'était passé! Les principaux acteurs du drame doivent
quitter la ville et s'exiler pour gagner leur vie. Le docteur Rodrigue s'en
retourne à Lachute où il devient éventuellement premier magistrat, et
Léonard Pagé va faire fortune dans la région de Sainte-Thérèse. W.H. Kelly
est humilié et poussé jusqu'au seuil de la pauvreté. En guise de
représailles, les Kelly font transférer les cendres de leur père hors des
murs de cette ville maudite. La peur, qui règne sur la ville, ne se dissipe
que très lentement et très péniblement. Il flotte d'ailleurs encore comme un
parfum de crainte sur Buckingham et on se refuse encore à assumer pleinement
ce passé pénible.
La paix revenue, la Compagnie MacLaren consolide son emprise sur la
Basse-Lièvre. Ce n'est qu'en 1935 d’ailleurs que son monopole est ébranlé.
La MacLaren, coincée par le gouvernement Taschereau, doit alors payer de
meilleurs salaires et se conformer au prix-plancher fixé par le reste de
l'industrie québécoise des pâtes et papiers. Plus tard, pendant la deuxième
guerre mondiale, elle doit s'ouvrir au syndicalisme. Les grandes compagnies
n'ont plus le même poids politique et ne peuvent plus, sans y mettre les
formes, agir à leur guise et contrôler les instances politiques et
judiciaires.
Un simulacre de justice
Les procédures judiciaires qui sont entamées par les autorités au lendemain
du 8 octobre 1906 prouvent l’imbrication incestueuse du judiciaire, du
politique et de l'économique et les procédures sont viciées. Les dés sont
pipés en faveur du pouvoir économique et politique et les syndicalistes vont
en payer le prix. Une première poursuite intentée contre Alex et Albert
MacLaren, J.E. Vallillee et les détectives, à la demande des avocats des
syndicalistes, est renvoyée par le juge Joseph T. St-Julien parce qu'il
manque la date sur un des documents. L'enquête entreprise par le Coroner
Alexandre Rodrigue sur la mort de Thomas Bélanger et de François Thériault
est interrompue par Lomer Gouin, Premier-ministre et Procureur-général du
Québec, qui intervient personnellement dans le déroulement de l'enquête. Le
docteur Rodrigue doit démissionner. Le coroner J.T.D. Fontaine de Maniwaki,
nommé par le gouvernement provincial pour remplacer le coroner Rodrigue,
annule l'enquête commencée par le docteur Rodrigue et démarre celle sur la
mort du détective Herbert Warner, ce "repris de justice" mort le 15 octobre
1906 d'un empoisonnement sanguin lié à une blessure reçue le 8 octobre au
"Landing". Ce faisant, le coroner Fontaine, décentre l'enquête en la
retournant contre les victimes syndicalistes. C'est le pauvre détective qui
est maintenant martyr et c'est l'action de Bélanger, Thériault et de leurs
amis qui est blâmée. Malgré cette façon de faire, le jury présidé par Désiré
Lahaie, rend un verdict de "non-responsabilité" dans la mort de Warner.
L'enquête sur la mort de Bélanger et de Thériault, tenue du 26 au 31 octobre
1906 et présidée par le coroner Edouard McMahon a selon lui un jury plus
"objectif". Le jury de l'enquête sur Warner se compose de onze francophones
et de cinq anglophones, de dix fermiers et de six habitants de la ville de
Buckingham : celui de l'enquête sur Bélanger et Thériault est fait de huit
anglophones et de huit francophones, tous des cultivateurs. Les intrants
ainsi contrôlés, le coroner McMahon réussit à obtenir un verdict mettant en
cause Alexander et Albert MacLaren, le chef de police Kiernan, le huissier
Cummings, le coroner Rodrigue, les détectives Picard, Ingram et Warner, les
unionistes Adélard Hamelin, Hilaire Charette, Jean-Baptiste Clément, Colbert
Bastien et Georges Robinson Croteau. Dans son rapport à Lomer Gouin, le
coroner McMahon s'excuse du fait que ce verdict "va peut-être trop loin"
mais il se défend en soulignant qu'il "a plu immensément au public de
Buckingham".
Les enquêtes préliminaires s'ouvrent le 26 novembre sous la présidence du
juge F.-X. Choquet de Montréal. Lomer Gouin lui confie personnellement
l'instruction de ces enquêtes. Au lieu de se servir des verdicts des
enquêtes de coroner pour dresser la liste des accusations, le juge Choquet
fait appel au détective K. P. McCaskill pour que soient effectuées de
nouvelles recherches. Résultat: l'homicide involontaire de Warner est ramené
à la surface, même si l'enquête du coroner Fontaine a conclu à la
non-responsabilité des syndicalistes dans cette affaire; Albert MacLaren se
voit exonéré; les détectives Joseph Lalonde, Joseph Delorme et I.J. Thompson
sont mis en accusation avec leurs collègues, et
Louis Landry, Cyrille
Tourangeau et le docteur Alexandre Rodrigue s'ajoutent aux syndicalistes qui
sont traînés devant les tribunaux.
Les procès sont entachés d'irrégularités, d'un remarquable parti-pris
anti-syndical et d'interventions politiques orchestrées par Charles Lanctôt,
l'adjoint de Lomer Gouin. Vraisemblablement inquiets face aux verdicts
précédents rendus par des jurés, Alexander MacLaren, John C. Cummings,
Francis Kiernan et les autres détectives optent pour un procès devant
magistrat plutôt que devant jury. Le premier de ces deux procès, ouvert le
18 février 1907 devant le juge J.-T. St-Julien, est le théâtre de deux
interventions remarquées de la part de Joseph-Timoléon St-Julien. Yvon
Lamontagne, avocat des syndicalistes, qui suit assidûment les procédures et
qui fournit aux avocats de la Couronne des renseignements qui servent contre
la défense, se fait interdire par le juge de prendre part aux procédures
malgré les objections de la Couronne, qui soutient avoir le droit de puiser
ses renseignements là où elle le veut. Le juge St-Julien ne veut rien
entendre. Le 23 février, l'avocat de la Couronne, qui doit se rendre à
Montréal, charge son adjoint de demander un ajournement au lundi 25 février,
ce qui, en temps normal, n’est qu’une formalité généralement accordée. Le
juge St-Julien refuse l'ajournement et rend son jugement sur le banc,
exonérant totalement Alex MacLaren, Cummings et Kiernan. En apprenant la
nouvelle, l'avocat de la Couronne déclare aux journaux qu'il va faire appel
de ce jugement. Mais il se ravise dans les heures qui suivent. Le 26
février, Charles Lanctôt lui fait parvenir une dépêche qui se lit comme suit
: "Ne faites pas demande d'appel à Cour du banc du roi. Re: Buckingham".
C.A. Wilson obéit et le lendemain, dans une lettre à Charles Lanctôt, il lui
explique qu'au moment précis où il recevait cette dépêche "les pièces de
procédures étaient prêtes et sur le point d'être signifiées. Comme
conséquence de votre dépêche, elles ne l'ont pas été" et de demander:
"Quelles sont les intentions du Département au sujet de la cause des six
autres?" Des instructions précises lui sont fournies par téléphone, dans la
matinée du 28 février. La volonté politique de Lomer Gouin transparaît
clairement. Il faut coûte que coûte exonérer le plus rapidement possible les
MacLaren et leurs amis. Les choses ne tardent pas, puisque les détectives
suivent l'exemple de leurs trois amis. Le 14 mars, ils sont acquittés de la
même manière, devant le même magistrat.
Il n'en est pas de même cependant des syndicalistes et de leurs amis. Les
pressions qui jouent en faveur des MacLaren auprès de Lomer Gouin jouent
contre les syndicalistes. Il faut absolument qu'un certain nombre d'entre
eux soient condamnés. Dans le cas d’Alex MacLaren et de ses amis, Charles
Lanctôt intervient pour bloquer un "appel"; dans le cas des syndicalistes,
il fait appel du jugement rendu par le juge F.-X. Talbot. Deux poids, deux
mesures. Le 19 novembre 1907,
Louis Landry, Colbert Bastien, Georges
Robinson Croteau, Adélard Hamelin, Hilaire Charette et J.-B. Clément sont
condamnés à deux mois de prison pour avoir participé à une émeute. Le
docteur Alexandre Rodrigue et Cyrille Tourangeau sont, quant à eux,
acquittés des accusations qui pesaient contre eux.
La liste noire
Il arrive qu'un employeur dresse une liste d'employés "militants" et
indésirables dont il refuse systématiquement l'embauche. Il est rare par
contre d'être confronté à une liste noire qui soit établie avec autant de
soins et maintenue avec autant d'acharnement pour une aussi longue période
qu'à la compagnie MacLaren.
Les dirigeants de la compagnie MacLaren décident d'établir une telle liste
dès le 23 septembre 1906. Dans une lettre à ses contremaîtres, Albert
MacLaren dit qu'il les avisera plus tard des hommes qui pourront être
réembauchés. Sous la férule de Robert MacLaren Kenny, la MacLaren refuse
même de donner du travail aux petits-fils d'ouvriers qui ont été mêlés aux
troubles de 1906, et ce, jusqu'en 1943, année de la reconnaissance
syndicale. Cette liste est alors officiellement mise au rancart à la suite
de pressions du syndicat. La Electric Reduction Company, quant à elle,
respecte les consignes données par la MacLaren au sujet de l'embauche, et,
malgré ses luttes avec cette dernière, elle maintient, jusqu'en 1944, des
politiques relativement paternalistes à l'endroit de ses employés.
Privés d'employeurs prêts à les embaucher, les unionistes de 1906 et ceux
qui ont le malheur de les appuyer sont contraints en grand nombre de quitter
Buckingham. C'est ce qu'affirme le rédacteur de la version française de la
brochure publiée à l'occasion du centenaire de la paroisse Saint-Grégoire.
Il s'agit vraisemblablement du curé Avila Bélanger. On soutient que la
population est alors passée "de 4425 à un peu plus de 3 850 habitants". |
PS :
À noter que
Alexandrine Landry, le premier enfant de
Louis Landry est née et
baptisée la veille des évènements, le 7 octobre 1906.

Dessin de la Une du journal La Patrie du 12 octobre 1906.
Articles du journal La Patrie de Montréal sur les
évènements du 8 octobre 1906 à Buckingham.
Une photo de toutes les pages du journal La Patrie de 1879 à 1978 a été placée
sur Internet par la Bibliothèque nationale du Québec. Journal quotidien, puis
hebdomadaire, La Patrie a été durant cent ans l’un des journaux à grande
diffusion du Québec. Ils sont disponibles au
https://bibnum2.banq.qc.ca/bna/patrie/.
Ici je présente les pages où l'on écrit sur les évènements du 8 octobre 1906.
8 octobre 1906 page 3
9 octobre 1906 page 1
9 octobre 1906 page 12
10 octobre 1906 page 1
11 octobre 1906 page 1
11 octobre 1906 page 4
12 octobre 1906 page 1
12 octobre 1906 page 6
13 octobre 1906 page 24
15 octobre 1906 page 1
15 octobre 1906 page 4
15 octobre 1906 page 10
16 octobre 1906 page 1
16 octobre 1906 page 11
17 octobre 1906 page 1
17 octobre 1906 page 11
18 octobre 1906 page 1
19 octobre 1906 page 9
19 octobre 1906 page 12
20 octobre 1906 page 7
20 octobre 1906 page 20
20 octobre 1906 page 24
22 octobre 1906 page 1
22 octobre 1906 page 7
26 octobre 1906 page 1
26 octobre 1906 page 10
27 octobre 1906 page 8
27 octobre 1906 page 24
29 octobre 1906 page 1
29 octobre 1906 page 4
29 octobre 1906 page 11
29 octobre 1906 page 12
30 octobre 1906 page 1
31 octobre 1906 page 1
31 octobre 1906 page 8
31 octobre 1906 page 12
2 novembre 1906 page 1
2 novembre 1906 page 6
2 novembre 1906 page 9
19 février 1907 page 12
20 février 1907 page 1
21 février 1907 page 16
22 février 1907 page 9
22 février 1907 page 10
16 mars 1907 page 5
16 mars 1907 page 24
11 novembre 1907 page 11
19 novembre 1907 page 5
20 novembre 1907 page 1
20 novembre 1907 page 3
20 novembre 1907 page 4
21 novembre 1907 page 12
1907
8 au 19 novembre 1907. Procès à Hull des six accusés.
19 novembre 1907. Les six accusés sont condamnés à deux mois de prison pour avoir participé à une
émeute. (Georges Robinson Croteau, Jean-Baptiste Clément, Adélard
Hamelin, Colbert Bastien, Louis Landry, et Hilaire Charette)
janvier 1908
Sortie de la prison de Hull des unionistes condamnés à deux mois de prison.
Louis Landry est le 2ième de la droite.
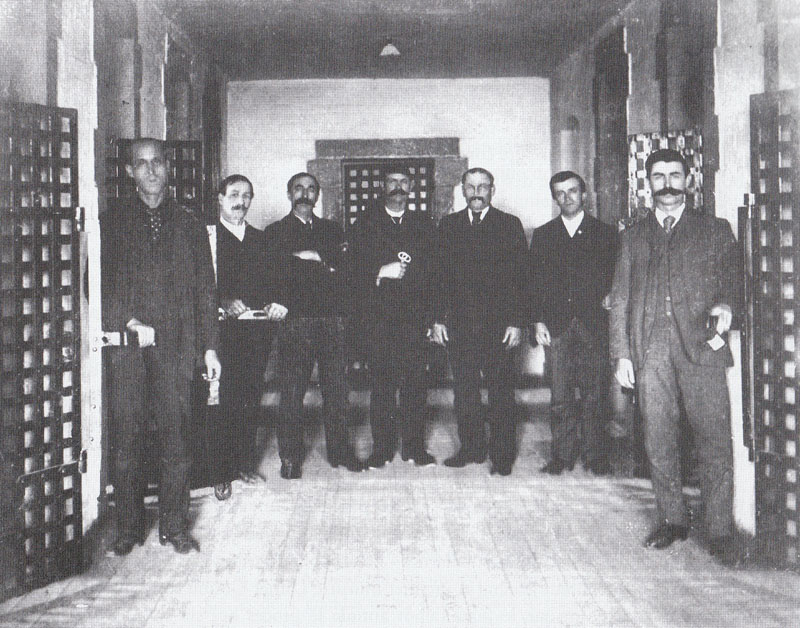
Publiée par Pierre Louis Lapointe dans son livre, La Vallée
Assiégée, 2006, page 212.
Publié également par la Société d'histoire de Buckingham.
https://www.histoiredebuckingham.com/
Gardien 1, Georges Robinson Croteau, Jean-Baptiste Clément,
Adélard Hamelin, Colbert Bastien, Louis Landry, Gardien 2
Des 6 unionistes condamnésà 2 mois de prison il manque Hilaire
Charette
25 janvier 1908. Banquet en l'honneur des participants aux évènements du 8
octobre 1906 à l'hôtel Alexandra.
1911
|
Recensement 1911 Document
du fédéral. 1911_165-45ou39-page26_québec_Labelle_Buckingham_ville
Sur le site on indique sous-district 45 mais sur la feuille 39. |
|
Lignes 21 à 29 ce sont des frères
indiqués comme Instruction Chrétienne. |
|
|
Lignes 30 à 32
Landry Louis mad mai 1861 50
Landry Calixte juillet 1885 26 religieux
Landry Alexina février 1888 23 organiste |
C'est la famille
Laure Daoust Landry
Laure Daoust
Calixte sera curé à Hammond en
1921.
Alexina est organiste à l'église.
Voir photo plus bas. |
|
lignes 33-38 Famille de Vincent
Gravel. |
|
|
Lignes 39 à 42
Landry Arthur mad octobre 1867
Landry Arthur fils décembre 1891
Landry Rosa fille juillet 1893
Landry Joseph fils mars 1895 |
C'est madame Arthur Landry soit
Victoria Carrière, aucun lien de parenté avec les précédents.
Joseph Landry est celui qui a acheté la Résidence Landry de la rue
MacLaren montrée sur la photo plus bas. Descendant de la lignée de
Guillaume Landry. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Référence :
https://www.collectionscanada.gc.ca
Vers 1911
Alexina Landry

Alexina Landry, soeur de Louis, organiste de l'église Saint-Grégoire-de-Naziance,
entourée de la chorale de la paroisse.
Publiée par Pierre Louis Lapointe dans son livre, La Vallée
Assiégée, 2006, page 176.
Deux bons livres sur le sujet.
Buckingham Ville Occupée de Pierre-Louis Lapointe, Les Éditions Asticou, Hull,
1983.
La Vallée Assiégée , Buckingham et la Basse-Lièvre sous les MacLaren, 1895-1945,
Pierre-Louis Lapointe, Éditions Vents d'Ouest, Gatineau, 2006.
Résidence Landry, 140
rue Maclaren Est, Gatineau (Buckingham), Québec
|

Cette élégante résidence de style
victorien fut construite en 1914 par Joachim Talbot, notaire de profession, qui
y demeura plusieurs années. De 1942 à 1981 elle appartenait à
Joseph Napoléon Landry et sa succession. Joseph Napoléon est un descendant
de Guillaume Landry, les Landry de l'île d'Orléans. Il était tailleur de métier.
Au début des année 1940 la mercerie J.N. Landry occupait le
503,
avenue de Buckingham. Aujourd'hui, Landry J N Enrg est situé au 467 avenue
de Buckingham, Gatineau (Buckingham) et est spécialisé en équipements et
vêtements de sécurité.
Photo Marcel W. Landry.

Au début des années 2000, il y a
eu un gîte du passant, le Bourg-Joie
qui a été remplacé depuis
par un sympathique café terrasse. Café le Bourg Joie, un café biologique et
équitable, joignable au 819-281-0960 ou au
cafelebourg-joie@bellnet.ca
sous la responsabilité de Suzanne et Henri Bourgeois.
Salle à dîner du Café Bourg-Joie.
André Landry, Henri Bourgeois et Marcel W.
Landry - 15 août 2007.
Photo Cécile Brousseau.
Source : André Landry, Coup de
coeur du patrimoine gatinois, Ville de Gatineau, 2006 et Société d'histoire de
Buckingham.
Information publiée sur le site
de la
Société d'histoire de Buckingham en août 2007 concernant le 140 rue Maclaren
est.
Historique
En 1899, le lot appartenait à Catherine Ackert, 45 ans, veuve de Michael
Fitzgerald. Catherine était la fille de Robert D. Ackert, commerçant et grand
ami de l'abbé John Brady, fondateur de l'Académie de Buckingham. Ackert fut
également membre du conseil d'administration de l'Académie. Quant à Michael
Fitzgerald, il était sans doute le fils de John Fitzgerald, enseignant à cette
même Académie. Le 5 avril 1899, le lot passa à la Corporation de la ville de
Buckingham, sans doute pour taxes non payées. Il fut racheté en avril 1908 par
Mary Ackert, 66 ans, soeur de Catherine et épouse de James McAndrew. Le même
jour, Mme Ackert le revendit à Mary S. Fitzgerald (sa nièce?). Le 26 mai 1911,
Anna St-Laurent, épouse de Joachim Talbot (avocat) acheta le lot. .Comme la
maison date de 1914, c'est Talbot qui la fit sans doute construire. Le 16
septembre 1919, Jean-Charles Langlois, avocat et plus tard juge, en devint
propriétaire. Puis, en 1921, ce fut au tour des Chevaliers de Colomb d'en faire
l'acquisition. Ceux-ci y restèrent durant 16 ans, et ils louaient
vraisemblablement une partie de la maison, car, en 1931, le nom de Émile Fortin
apparaît comme locataire dans les rôles d'évaluation de la ville. En 1937,
Claude Bertrand, 39 ans, acheta la propriété. À la même époque Peter MacLachlan,
médecin, en était locataire. En 1942, la résidence passa aux mains de
Joseph
Landry qui l'habita presque 40 ans. Au cours des années 1990 Henri Bourgeois et
Suzanne Thériault, fit l'acquisition de la résidence appartenant alors à la
succession de Joseph Landry, propriétaire depuis 1978. Ils firent de la demeure
un gîte ‚ Le Bourg-joie ‚ qu'ils exploitèrent jusqu'en2005. En cette même année
Sami Chakie, propriétaire du café Moca Loca , dans le secteur Gatineau, acheta
la résidence et transforma l'intérieur en un jolie café, qui porte également le
nom de Moca Loca.
Chaîne de titres
Date de transaction / Propriétaire(s) / No. de l'acte de vente
? 1899 Catherine Ackert (Veuve de Michael Fitzgerald)
5 avril 1899 Corporation de la ville de Buckingham No. 3
18 avril 1908 Mary Ackert (épouse de James McAndrew) No. 14648
18 avril 1908 Mary S. Fitzgerald No. 14649
26 mai 1911 Anna St-Laurent (épouse de Joachin Talbot) No. 18845
16 septembre 1919 Jean-Charles Langlois et al. No. 32040
8 août 1921 Chevaliers de Colomb (par cession) No. 33935
17 décembre 1937 Claude Bertrand No. 50093
12 mars 1942
Joseph Landry No. 55107
15 décembre 1978 Succession de
Joseph Landry No. 153849
janvier 1981 Marcel Mercier, Madone Guénette
septembre 1996 Henri Bourgeois et Suzanne Thériault
Société d'Histoire de Buckingham
379, Avenue de Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2G6
Tél : (819) 281-7111
soc_hist_buck@hotmail.com
|
Pierres tombales du
Cimetière de Buckingham
Marcel Walter Landry - Pour toute question ou problème concernant ce site Web,
envoyez moi un courriel.
Dernière modification
: dimanche 11 janvier 2026
|